Qu’est-ce qu’un immigré ?
Un immigré est différent d’un étranger (plus d’un million de nos immigrés sont des Français naturalisés). En 2013, la part des immigrés dans la population française totale est d’environ 9 %.
L’immigration a un impact sur :
- la démographie ;
- les finances publiques ;
- le marché du travail ;
- le taux de salaire ;
- le taux de chômage.
Les caractéristiques moyennes d’un immigré sont :
- des difficulté d’intégration sur le marché du travail et dans la société en général ;
- une moindre qualification ;
- plus de périodes de chômage (notamment pour les immigrés extra-communautaires) ;
- plus d’enfants (mais les immigrés ne font monter le nombre d’enfants par femme que de 1.8 (pour les femmes françaises) à 1.9 (pour la population totale)).
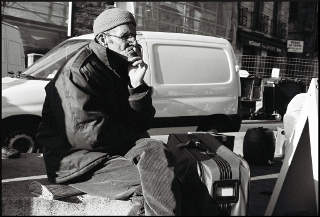
L’attraction de la protection sociale (ou magnet effect).
La générosité de la protection sociale constitue une attraction réelle, mais le déterminant principal à l’immigration demeure le salaire. Néanmoins, les extra-communautaires sont sur-représentés dans la population bénéficiant des aides sociales, tandis que la part des immigrants intra-communautaires est proche de celle des natifs.
Recours aux aides sociales : caractéristique socio-économique ou comportement inhérent aux immigrés ?
L’évaluation du magnet effect se base sur le critère de sur-représentation résiduelle, c’est-à-dire que seul le statut d’immigré expliquerait le recours à telle ou telle aide sociale.
Ainsi, à caractéristiques socio-économiques équivalentes (âge, nombre d’enfants, etc.) :
- les immigrés ont plus souvent recours au revenu minimum et sont plus souvent au chômage ;
- le recours aux aides au logement et à la famille sont les mêmes entre immigrés et natifs ;
- les immigrés bénéficient moins des pensions de retraite et des prestations de santé que les natifs.
Ce magnet effect est-il généralisé ?
Les études comparatives entre pays sont complexes car elles dépendent :
- de la protection sociale du pays ;
- de la nature de son immigration.
Néanmoins, une étude portant sur 11 pays européens a livré des résultats similaires sur la question du magnet effect.
sommaireLe poids des immigrés dans les finances publiques : contributions et perceptions.
Notons d’abord qu’en France, 85 % des prélèvements et 75 % des dépenses publiques sont individualisés, c’est-à-dire spécifiques à des catégories socio-économiques. À l’inverse, les dépenses du secteur de la Défense bénéficient à tous : elles ne sont pas individualisées.
Donc, pour un individu moyen de même situation socio-économique, on constate que les immigrés et les natifs contribuent plus qu’ils ne perçoivent entre 25 et 60 ans. Or :
- cette contribution est plus importante chez les natifs que chez les immigrés ;
- mais la part d’actifs dans la population immigrée est plus importante que la part d’actifs dans la population native (55 % contre 40 %). En effet, la structure par âge est différente entre natifs et immigrés.
Ainsi, en 2005, la contribution nette globale des immigrés au budget de l’administration publique était positive (+4 milliards d’euros). Néanmoins, cette contribution reste faible. En général, les études concluent que le poids des immigrés sur les finances publiques à court terme, qu’il soit positif ou négatif, est relativement neutre. Il en est de même dans la plupart des pays européens.
sommaireAnalyse dynamique de l’immigration.
L’immigration en France est essentiellement permanente, et non saisonnière. Donc, l’impact de l’immigration gagne à être calculée à long terme (analyse dynamique, opposée à analyse statique).
Il existe deux méthodes d’analyse dynamique :
- comptabilité générationnelle : évaluer l’influence d’un individu sur tout son cycle de vie (donc, l’influence de ses descendants y compris). À propos de l’impact des immigrés sur les finances publiques, les conclusions de ce type d’analyse concordent avec les analyses statiques : leur impact est très légèrement positif, par effet d’équilibre général (les impacts positifs et négatifs sur l’ensemble des domaines s’équilibrent) ;
- modèle d’équilibre général calculable dynamique : l’impact de l’effet d’équilibre général est lui-même pris en compte. Pour l’analyse du poids de l’immigration sur les finances publiques, cette méthode d’analyse se veut prospective : quelle pourrait être la France demain sans les immigrés ?
La France demain si le solde migratoire est nul.
En moyenne, chaque année en France et depuis une dizaine d’années, 100 000 émigrent et 200 000 personnes immigrent (intra et extra-communautaires). Donc, s’il y avait un solde migratoire nul en France et ce, comparativement aux projections officielles de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) :
- en termes de démographie, la population en âge de travailler serait réduite : −10 % en 2050 et −25 % en 2100. En outre, la population native étant plus âgée que la population immigrée, le rapport entre les plus de 65 ans et la population active augmenterait de +4,5 points pour passer à près de 50 % en 2100 (c’est-à-dire qu’il y aurait 1 retraité pour 2 actifs).
- en termes de besoin de financement de la protection sociale, le déficit en 2050 serait de 2,8 % du PIB (produit intérieur brut) pour les retraites, et de 3,4 % pour la santé. Avec le flux migratoire actuellement prévu, ce déficit tombe à 1,7 % du PIB pour les retraites, et à 3,2 % pour la santé. Les autres branches de la protection sociale, moins dépendantes de la structure par âge, demeurent excédentaires.
Conclusion : à court et long termes, l’immigration ne pèse pas sur les finances publiques, et y contribue même légèrement. Quant à son rôle sur le financement de la protection sociale, il est bénéfique et provient de sa structure par âge.
sommaireL’immigration peut-elle donc sauver notre protection sociale ?
Quelle serait la taille optimale de la population pour l’économie française ?
Le taux de croissance de la population a un effet sur le taux de croissance économique et sur le niveau de richesse par tête. Par contre, le niveau de la population est relativement neutre sur ces indicateurs. Donc, l’augmentation de la population par les immigrés ne peut empêcher ou mener à une taille optimale de population.
L’immigration peut-elle couvrir les effets du vieillissement démographique ?
On parle de vieillissement démographique quand le ratio de dépendance, c’est-à-dire le rapport entre les plus de 65 ans et la population active, est croissant. La situation peut s’expliquer par :
- un phénomène de vieillissement par le bas (de la pyramide des âges) : le taux de natalité baisse, donc le nombre de jeunes est plus faible. Ce phénomène ne touche pas la France.
- un phénomène de vieillissement par le haut : l’espérance de vie augmente, donc le nombre de personnes âgées est plus important.
Dès lors en France, la population immigrée (structurellement plus jeune) peut-elle réduire le fardeau fiscal du viellissement par le haut ? Non, car les jeunes immigrés d’aujourd’hui deviendront les +65 ans de demain. Donc, pour maintenir le ratio de dépendance à l’idéal de 25% (1 retraité pour 4 actifs), il faudrait un flux d’immigrés qui doublerait la population française tous les 40 ans (processus cumulatif).
sommaireL’immigration sélective est-elle finalement la solution ?
Économiquement, une immigration de travailleurs qualifiés — et donc s’intégrant d’autant plus facilement sur le marché du travail — profiterait aux finances publiques.
Néanmoins, à très long terme, cette politique sélective est moins bénéfique que la non-sélective. En effet :
- le taux de natalité (bénéfique sur les finances publiques) est décroissant avec le niveau de qualification ;
- l’augmentation de l’espérance de vie (qui pèse sur ces finances) est croissante avec le niveau de qualification.
RAGOT, Lionel. Immigration et finances publiques. Séminaire du à l’Université de Paris Ouest. [retour à la référence]